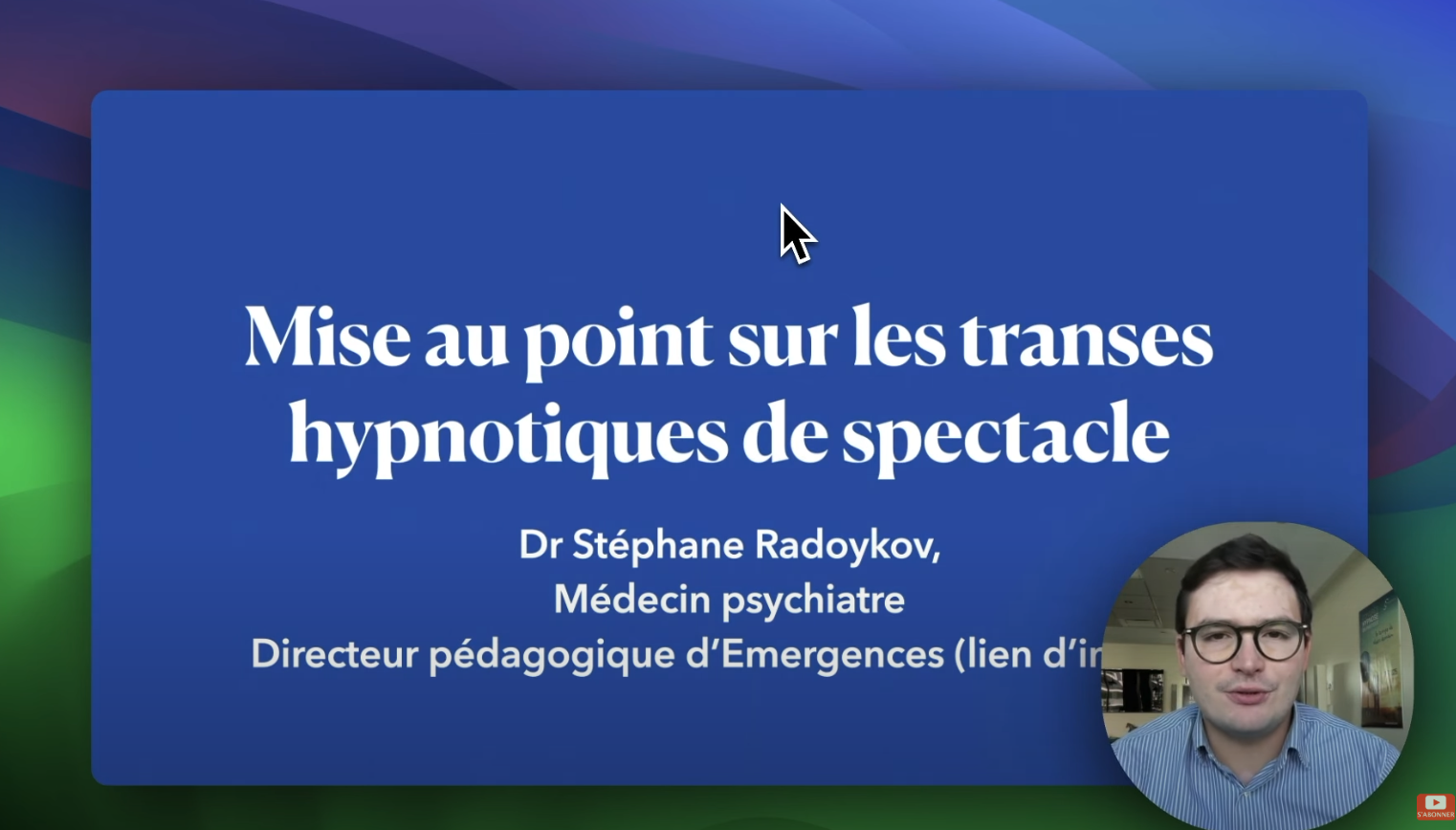Hypnose de spectacle : bénéfices ou dangers pour le sujet
Dr Stéphane Radoykov

Dr Stéphane Radoykov
Médecin psychiatre en cabinet, ancien chef de clinique assistant à l'hôpital Cochin (AH-HP). Formateur et directeur adjoint de l’Institut Emergences. Cofondateur du comité jeunesse de l’ISH.
D’un côté l’hypnose de spectacle, de l’autre l’hypnose thérapeutique. Les hypnotiseurs acteurs de divertissement face aux hypnothérapeutes professionnels de santé. Deux mondes aux démarches bien différentes pour lesquels des études permettent de peser risques et bénéfices, tout en soulevant des questions d’éthique.
L’hypnose de spectacle fascine autant les scientifiques que le public depuis plus de cent ans (1). Cependant, derrière le rideau de l’amusement et du divertissement se cachent des enjeux éthiques et des risques potentiels pour les participants. Une loi belge interdit à juste titre l’hypnose de spectacle (loi du 30 mai 1892) et a amené les autorités à annuler un spectacle en 2017 (2). Dans cet article, nous allons explorer la balance bénéfice/risque de l’hypnose de spectacle, à partir d’une revue PubMed
Qu’est-ce que l’hypnose de spectacle ?
La définition de l’hypnose est l’association d’une focalisation de l’attention, d’une moindre attention au monde environnant, et d’une capacité plus grande de réponse aux suggestions de l’hypnotiseur. Cette définition est valable aussi bien dans l’intention de soin que de spectacle. L’hypnose de spectacle est une forme d’hypnose utilisée principalement pour divertir un public. Contrairement à l’hypnose thérapeutique, qui vise à aider les individus à surmonter des problèmes personnels et à soulager la douleur et l’anxiété, l’hypnose de spectacle se concentre sur la performance et le divertissement. Elle implique des démonstrations amusantes et mystérieuses où les participants semblent perdre le contrôle de leurs actions sous l’influence de l’hypnotiseur. Pour les professionnels de santé, à l’inverse, une des règles fondamentales est « primum non nocere », qui signifie, avant toute chose, éviter de faire du mal aux patients. Pour cela, dans la méthode d’hypnose ericksonienne, et durant la formation en hypnose médicale et thérapies brèves, nous posons un cadre éthique très clair pour chaque praticien, qui interdit formellement toute pratique de l’hypnose à visée de divertissement (3).
Bénéfices pour le public qui regarde le spectacle d’hypnose
Les spectacles d’hypnose sont souvent perçus par les membres du public comme amusants et captivants, offrant une expérience unique aux spectateurs, et leur apportant une réduction d’anxiété (4) (8). En revanche, la même étude n’a retrouvé aucune amélioration de l’état émotionnel des six personnes montées sur scène. Il faudrait donc au minimum un consentement éclairé plus étoffé des participantes et participants qui prêtent leur corps et leur esprit à l’expérience.
Effets secondaires pour les participants à la transe sur scène
Plusieurs situations ont été décrites, lors desquelles les sujets sur scène de spectacle ont vécu l’état d’hypnose de façon néfaste.

Absence de bénéfices et risques émotionnels
Lors d’une enquête chez 22 participants à un show d’hypnose, la plupart on trouvé cela positif et agréable. Cinq personnes ont toutefois développé une amnésie dissociative de l’expérience. De plus, cinq personnes avaient la conviction que l’hypnotiseur avait pris le contrôle de leur corps (8). Une autre enquête auprès de 8 sujets ayant participé à la fois à de l’hypnose de spectacle et à de l’hypnose pour les soins a retrouvé des différences entre les deux pratiques. L’hypnotiseur de spectacle aurait eu un style sensationnel qui veut montrer quelque chose d’extraordinaire, et administré des ordres, alors que les professionnels de santé hypnopraticiens auraient été plutôt posés, calmes et factuels durant la consultation, et faisaient des suggestions (9). Milton Erickson a publié quelques cas observés où, cinq à sept mois après une catalepsie du corps entier sur scène (corps allongé entre deux chaises), les personnes développaient des lombalgies (douleurs du dos) (14).
Les participants sur scène ne retireraient pas de bénéfice émotionnel de l’expérience (4) (à l’inverse du public qui s’amuse et se détend) et peuvent même ressentir des effets négatifs. Des cas de décompensation psychotique, de syndromes anxieux et dépressifs ont été rapportés chez certains participants aux hypnoses de spectacle, soulignant donc ses dangers potentiels.
Une participante de 19 ans aurait déclenché un syndrome anxiodépressif une semaine après un spectacle d’hypnose utilisant des techniques rapides (manipulation du cou, régression à un âge jeune et « redevenir un bébé qui pleure pour sa mère »). Elle a pu obtenir réparation de l’hypnotiseur de spectacle : reconnu coupable de négligence et d’agression, et condamné à une indemnisation (5).
Un vétéran âgé de 35 ans sans antécédents psychiatriques a subi la décompensation d’un épisode psychotique aigu le soir même d’un spectacle d’hypnose, un an après sa blessure de guerre (6). Une autre personne a souffert d’une décompensation délirante activée suite à une hypnose de spectacle, et réactivée deux mois plus tard en revoyant l’hypnotiseur de spectacle à la télévision (10). Nous rappelons que les personnes souffrant de psychose sont fragiles et ont besoin de douceur, contenance et réassociation, plutôt que de dissociation, leur esprit étant déjà assez désorganisé par la maladie.
Une personne ayant subi une hypnose rapide, sans prise en compte de son histoire de vie, a réactivé des souvenirs traumatiques de la Seconde Guerre mondiale, quand elle était cachée chez des résistants. L’hypnotiseur lui avait suggéré de retourner à un âge jeune. Elle a déclenché des signes aigus de stress post-traumatique (7).
Les personnes souffrant de psychose sont fragiles et ont besoin de douceur, contenance et réassociation.
Relation de manipulation et domination
Les hypnotiseurs de spectacle peuvent exercer une influence excessive sur les participants, comme une fureur de fasciner à tout prix, ce qui peut être déshumanisant et entraîner des clivages au sein des groupes, ou à l’inverse un mouvement de foule de type fascination inadaptée (admiration). Dans une étude avec 202 sujets, 105 provenant d’un show, 52 venant d’un cours sur l’hypnose, et 48 ayant été refusés à un show car il n’y avait plus de places, et servant de témoins, les auteurs retrouvaient (11) : les personnes ayant eu un cours d’hypnose avaient moins l’impression que la personne en hypnose est un robot versus ceux qui ont été témoins du show qui croyaient davantage que le sujet devient un robot. D’autres auteurs jugent également la balance bénéfice/risque de l’hypnose de spectacle en défaveur pour les sujets hypnotisés (12) (13).
Considérations éthiques
L’hypnose de spectacle soulève donc des questions éthiques importantes, notamment en ce qui concerne l’utilisation des individus comme objets de divertissement. Des lois de bioéthique existent pour protéger la population française depuis 1994, mais le débat sur le sujet de l’hypnose reste actif. Historiquement, des figures médicales comme Charcot et de La Tourette auraient déjà proposé de restreindre l’hypnose aux professionnels de santé, il y a plus de cent ans, soulignant l’importance de l’éthique dans cette pratique (1) (12). Nous rappelons deux principes en médecine : « Primum non nocere », et le consentement éclairé avant toute intervention.
CONCLUSION
En conclusion, la balance bénéfice/risque de l’hypnose de spectacle semble pencher en défaveur pour les participants sur scène, tout en offrant un certain plaisir anxiolytique au public. De plus, les hypnoses de spectacle reproduisent des interactions humaines fondées prioritairement sur la performance, la domination ou la soumission. Nous préférons privilégier des relations humaines basées sur la coopération, la confiance et l’accueil de la vulnérabilité, comme c’est le cas dans l’hypnose thérapeutique.

Cet article est disponible dans la revue "Hypnose & Thérapies brèves" n°78
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Graus A., « Hypnosis lessons by stage magnetizers : Medical and lay hypnotists in Spain », Notes Rec. R. Soc. Lond., 2017, Jun. 20, 71 (2), pp. 141-156. doi: 10.1098/rsnr.2017.0009. PMID: 30125056
2. https://www.rtl.be/art/info/belgique/societe/l-hypnosede-spectacle-presente-t-elle-des-risques-il-y-a-un-danger--972054.aspx
3. https://www.hypnoses.com/qui-sommes-nous/notre-charte-ethique
4. MacKillop J., Jay Lynn S., Meyer E., « The impact of stage hypnosis on audience members and participants », « Int. J. Clin. Exp. Hypn. », 2004, Jul., 52 (3), pp. 313-329. doi: 10.1080/0020714049052353. PMID: 15370360.
5. « Damages against stage hypnotist », « Br. Med. J. », 1952, Apr. 12, 1 (4762), pp. 823-824. PMID: 14916161.
6. Wain H.J., Dailey J., « A dissociative episode following stage hypnosis in a combat-injured soldier: implications, treatment and reflections », « Am. J.
Clin. Hypn. », 2010, Jan., 52 (3), pp. 183-188. doi: 10.1080/00029157.2010.10401718. PMID: 20187337
7. Kleinhauz M., Dreyfuss D.A., Beran B., Goldberg T., Azikri D., « Some after-effects of stage hypnosis: a case study of psychopathological manifestations », « Int. J. Clin. Exp. Hypn., 1979, Jul., 27 (3), pp. 219-226. doi: 10.1080/00207147908407563. PMID: 541135.
8. Crawford H.J., Kitner-Triolo M., Clarke S.W., Olesko B., « Transient positive and negative experiences accompanying stage hypnosis », « J. Abnorm. Psychol.», 1992, Nov., 101(4), pp. 663-667. doi: 10.1037//0021-843x.101.4.663. PMID: 1430605.
9. Echterling L.G., « Contrasting stage and clinical hypnosis», « Am. J. Clin. Hypn. », 1988, Apr., 30 (4), pp. 276-84. doi: 10.1080/00029157.1988.10402750. PMID: 3364391.
10. Allen D.S., « Schizophreniform psychosis after stage hypnosis », « Br. J. Psychiatry », 1995, May, 166 (5), p. 680. doi: 10.1192/bjp.166.5.680a. PMID: 7620761.
11. Echterling L.G., Whalen J., « Stage hypnosis and public lecture effects on attitudes and beliefs regarding hypnosis », « Am. J. Clin. Hypn. », 1995, Jul., 38 (1), pp. 13-21. doi: 10.1080/00029157.1995.10403173. PMID: 8533735.
12. Mott T. Jr., « Untoward effects associated with hypnosis », « Psychiatr Med.», 1992, 10 (4), pp. 119-128. PMID: 1289957.
13. Meeker W.B., Barber T.X. (1971), « Toward an explanation of stage hypnosis », « Journal of Abnormal Psychology », 77 (1), pp. 61-70. doi: 10.1037/h0030419
14. Erickson M.H., 1962, « Stage Hypnotist Back Syndrome », « American Journal of Clinical Hypnosis », 5 (2), pp. 141-42. doi:10.1080/00029157. 1962.10402279